Dette publique :le libéralisme en faillite
Par Jean-Marie Harribey, économiste à l’université Bordeaux-IVJe rajoute, à priori membre d'ATTAC, belle neutralité !
par Jean-Marie Harribey
Université Montesquieu-Bordeaux IV
Il y quelques temps déjà Journarles organisait une projection-débat sur le thème de l’argent. Le débat se prolonge aujourd’hui dans l’actualité autour de la dette publique qui menacerait notre pays de faillite. Un discours démonté point par point par un excellent argumentaire de Jean-Marie Harribey dans l’humanité...
Un débat chasse l’autre, mais les mêmes errements reviennent pour mêler la question de la dette publique à celle des retraites. Le ministre de l’Économie, Thierry Breton, affirme que la dette des administrations publiques n’est pas de 1 100 milliards d’euros mais de 2 000 milliards, car il faut y ajouter les engagements de l’État à l’égard des fonctionnaires et des agents des entreprises publiques actuellement en activité lorsqu’ils feront valoir leurs droits à la retraite.
Le rapport de Michel Pébereau, même s’il est plus discret sur le bien-fondé de cette addition, fait état du même problème et estime entre 790 et 1 000 milliards ces engagements supplémentaires. Certains vont encore plus loin : Pascal Gobry, membre de l’Institut des actuaires, affirme que « la France est en faillite », car cette dette est de « 3 000 milliards au bas mot ». Il écrit (le Monde, 16 décembre) : « L’estimation des engagements en matière de retraites doit répondre à la question : et si tout s’arrêtait à la seconde, si on ne recrutait plus, si les gens en activité exigeaient soudain leurs droits à retraite, et si on payait toutes leurs retraites aux déjà retraités, jusqu’à leur décès ? Combien cela coûterait-il ? » On peut répondre tranquillement : zéro. Parce que la question est absurde. Si tout s’arrêtait, si plus aucun travailleur ne travaillait, rien ne serait produit, aucun revenu ne serait engendré et il n’y aurait rien à distribuer, ni en salaires, ni en retraites, ni en profits. Pour montrer l’étendue de la « faillite de l’État », l’auteur poursuit : « Même s’il vendait à des Japonais le château de Versailles au prix fort, la tour Eiffel, le musée du Louvre, tout son patrimoine, l’État français ne pourrait honorer ses engagements sur les retraites et les salaires. » Ainsi se perpétue l’erreur consistant à croire que les revenus sont versés en prélevant sur un stock, alors qu’ils sont un flux engendré par l’activité productive courante. Ainsi refait surface la conception qui a inspiré les réformes Balladur de 1993 et Fillon de 2003 : transformer le système des retraites par répartition fondé sur la mutualisation d’une part de la richesse produite en un système d’épargne individuelle, tout en laissant croire qu’individus et État mettent des sous dans un bas de laine pour les exhumer au moment voulu. Les engagements envers les salariés du public, comme ceux du privé - ce que le ministre s’est bien gardé de dire -, sont gagés sur le flux de la production future et non pas sur un stock accumulé, ni sur le flux présent, ni a fortiori sur le mirage de fonds de pension stériles. Et le respect de ces engagements dépendra de l’évolution de la production et surtout de sa répartition entre masse salariale et profits.
Cette erreur est à la racine de l’imbroglio théorique et de la mystification politique entourant hier la question des retraites et aujourd’hui celle de la dette que le ministre veut amalgamer. On ne peut ajouter la dette financière de l’État et les engagements de la collectivité à verser des retraites. L’État ne verse aucun intérêt sur les sommes correspondant à ces engagements. Et si, un jour, il devait en payer, ce serait parce qu’il refuserait d’augmenter les cotisations vieillesse pour ne pas contrarier les actionnaires et s’obligerait alors à se tourner vers les marchés financiers sur lesquels des fonds de placement s’empresseraient d’acheter les obligations d’État.
La vraie dette, c’est celle qu’il faudra rembourser, sauf dénonciation, celle qui absorbe aujourd’hui sous forme d’intérêts (40 milliards d’euros annuels) la totalité de l’impôt sur le revenu. Est-elle trop élevée, croît-elle trop vite par rapport au PIB, puisqu’elle atteint l’équivalent de 66 % de celui-ci ? Est-elle le « fardeau légué aux générations futures » si souvent dénoncé ? Par définition, une créance de même montant est transmise simultanément à une dette. Si, comme tout le laisse à penser, les classes aisées achètent les obligations d’État, leurs descendants en hériteront. Où est le problème ? Il naît lorsque la structure de la fiscalité est telle que ce sont les classes pauvres qui paient et paieront l’impôt dans une proportion inverse à ce que commanderait la justice, parce que l’impôt indirect non progressif est prédominant par rapport à l’impôt direct progressif. Le « fardeau » de la dette publique n’est pénalisant qu’en raison d’une fiscalité redistributive à l’envers et non pas à cause du montant de la dette. Et cela d’autant plus que les nouveaux emprunts des collectivités publiques ont pour but non de réaliser des investissements d’avenir (éducation, recherche, écologie, etc.), mais de couvrir un service de la dette antérieure de plus en plus lourd, pendant qu’on allège constamment la fiscalité sur les riches. Jacques Marseille a beau affirmer (le Monde, 13 décembre) que « la lutte des classes n’est pas entre les bourgeois et les prolétaires, elle est entre les créanciers et les débiteurs », tout montre que les bourgeois sont les créanciers et qu’échoit aux prolétaires la tâche d’endosser la dette publique, laquelle n’est jamais qu’une créance privée.
L’interdiction faite à la Banque centrale européenne de créer de la monnaie pour financer les dépenses collectives (qui était consacrée par l’article III-181-1 de l’ex-projet de traité constitutionnel) est cohérente avec une politique qui s’obstine à nourrir la rente financière aux dépens des emplois utiles et laisse monter le chômage dont sont victimes ou menacés ceux qui devront prendre en charge la dette grossie au fil des ans à cause de la baisse des impôts et de l’écart positif entre les taux d’intérêt et le taux de croissance économique. Politique cohérente aussi avec la libre circulation des capitaux, qui permet à des résidents de posséder autant d’avoirs extérieurs que les non-résidents en possèdent en France, phénomène interdisant d’invoquer une dépendance vis-à-vis de l’étranger.
La France n’est donc pas en faillite, quoi qu’en disent les Cassandre du déclin ; l’État non plus, car le solde primaire (hors intérêts) de son budget est proche de l’équilibre. En revanche, le libéralisme est en faillite : en tant que doctrine qui n’a aucune portée heuristique, et en tant que projet normatif pour une société dont il programme le délitement. Face à cela, et en réponse à l’augmentation de la dette, il faudra une double révolution : fiscale, pour récupérer les intérêts, et monétaire, pour maîtriser la Banque centrale. Le principe en avait été posé par Keynes il y a soixante-dix ans : l’euthanasie des rentiers.
Par Jean-Marie Harribey, économiste à l’université Bordeaux-IV. © Journal l’Humanité
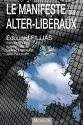

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire